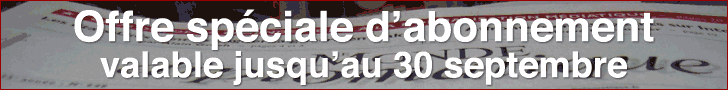Si c’était une attraction de la Fête à Neu-Neu, pour y faire venir des intellectuels, on l’appellerait « le trombinoscope giratoire » — et pour les plus petits « le manège aux cornichons ». A la télévision, à la radio, dans la presse écrite, qui pour commenter l’effondrement du capitalisme financier ? Les mêmes, bien sûr ! Tous, experts, éditorialistes, politiques, qui nous ont bassinés pendant deux décennies à chanter les louanges du système qui est en train de s’écrouler : ils sont là, fidèles au poste, et leur joyeuse farandole ne donne aucun signe d’essoufflement. Tout juste se partagent-ils entre ceux-ci qui, sans le moindre scrupule, ont retourné leur veste et ceux-là qui, un peu assommés par le choc, tentent néanmoins de poursuivre comme ils le peuvent leur route à défendre l’indéfendable au milieu des ruines.
Parmi eux, Nicolas Baverez est visiblement sonné et cherche son chemin parmi les gravats. L’effet de souffle a dû être violent car le propos est un peu à l’état de compote : « La mondialisation conserve des aspects positifs (1) », maintient-il contre vents et marée, non sans faire penser à Georges Marchais. Pourtant, lâche-t-il dans un souffle, c’est bien le « capitalisme mondialisé qui est entré en crise (2) », et « l’autorégulation des marchés est un mythe (3) ». Il n’empêche : « Le libéralisme est le remède à la crise (4) . » Or qu’est-ce que le libéralisme, sinon la forme d’organisation économique déduite du postulat de l’autorégulation des marchés ? Peut-être, mais Baverez décide qu’il ne reculera plus d’un pouce là-dessus et qu’il faudra faire avec les complexités de sa pensée : « Le libéralisme n’est donc pas la cause de la crise », quoique par autorégulation interposée il soit le problème... dont il est cependant « la solution (5) » — comprenne qui pourra.
D’autres sont moins désarçonnés et font connaître avec plus d’aisance que, si les temps ont changé, eux aussi sont prêts à en faire autant. « Cette bulle idéologique, la religion du marché tout-puissant, a de grandes ressemblances avec ce que fut l’idéologie du communisme (...). Le rouleau compresseur idéologique libéral a tout balayé sur son passage. Un grand nombre de chefs d’entreprise, d’universitaires, d’éditorialistes, de responsables politiques ne juraient plus que par le souverain marché (6). »
Celui qui, telle la Belle au bois dormant, se serait endormi avant l’été pour se réveiller et lire ces lignes aujourd’hui croirait sans doute avoir affaire une fois de plus à ces habituels fâcheux d’Attac ou bien de L’Humanité. C’est pourtant Favilla, l’éditorialiste masqué des Echos, qui libère enfin toute cette colère contenue depuis tant d’années. Car on ne le sait pas assez, Les Echos sont en lutte : trop d’injustices, trop de censures, trop d’impostures intellectuelles. N’a-t-on pas étouffé la « vérité » même : « Toute voix dissonante, fût-elle timidement sociale-démocrate, en rappelant les vertus d’un minimum de régulation publique, passait pour rescapée de Jurassic Park. Et voici que tout à coup la vérité apparaît. L’autorégulation du marché est un mythe idéologique. » Prolongeant les tendances présentes, on peut donc d’ores et déjà anticiper qu’un sonnant « Il faut que ça pète ! » donnera bientôt son titre à un prochain éditorial d’un Favilla déchaîné.
Prophètes diplômés
Décidément Blanche-Neige aurait du mal à reconnaître ses nains. Laurent Joffrin, qui il y a quelques mois encore aidait Bertrand Delanoë à pousser son cri d’amour pour le libéralisme et fustigeait la « gauche Bécassine (7) », celle qui n’a pas compris les bienfaits du marché, a visiblement mangé de la mauvaise pomme — en fait la même que Favilla : « Depuis plus d’une décennie, les talibans du divin marché financier ont rejeté tous les avertissements, méprisé tous les contradicteurs et récusé toute tentative de régulation (8). » On en était resté au moment où les talibans faisaient cause commune avec les critiques de la mondialisation. Se peut-il que les enturbannés aient si brutalement changé de camp, en fait depuis si longtemps, et sans même qu’on s’en soit aperçu ?
A leur décharge, ces pauvres éditorialistes ne faisaient qu’ânonner ce que leur avaient seriné pendant tant d’années leurs répétiteurs experts. Or, de ce côté, l’hécatombe est impressionnante également. Elie Cohen, qui a beaucoup donné de sa personne pour avertir de l’effrayante aberration en quoi consiste l’intervention publique, et soutenu la privatisation de tout ce qu’il y avait à privatiser, est maintenant d’avis qu’il faut nationaliser — on imagine sa tête si on lui en avait soumis l’idée il y a deux mois. Comme elle semble loin l’époque où il enjoignait encore les socialistes de rompre avec le « discours d’ultragauche fondé sur le déni de la réalité (9) » et regrettait beaucoup qu’ils soient « devenus altermondialistes par peur d’une mondialisation qu’ils ne comprenaient pas et dans laquelle ils ne voyaient que les manifestations de multinationales assoiffées de profits, les dérives d’une finance débridée et les inéquités d’une régulation au service des puissants ».
Il n’est pas un mot de cette adresse qui n’impressionne par sa lucidité puisque, comme chacun sait, non seulement le Parti socialiste est un repaire d’altermondialistes, mais il faut en effet ne rien comprendre à la mondialisation pour en donner pareil portrait que la réalité infirme chaque jour davantage. Il est vrai qu’en matière de « réalité » Cohen est un expert : « Dans quelques semaines, le marché se reformera et les affaires reprendront comme auparavant », écrit-il le 17 août 2007 (10), avant de livrer sa philosophie (presque) définitive des crises financières : « Il faut s’habituer à l’idée qu’elles ne constituent pas des cataclysmes mais des méthodes de régulation d’une économie mondiale qu’on n’arrive pas vraiment à encadrer par des lois ou des politiques (11). »
Des gens malintentionnés iront sans doute suggérer que Cohen n’est pas le type même de l’économiste académique et que, avec le temps qu’il passe sur les plateaux, on se demande s’il a jamais pu faire effectuer le moindre progrès à une science autre que celle de sa propre notoriété. Sans même trancher sur le fond cette épineuse question, disons tout de suite qu’il y a quelque chose de très injuste dans cette insinuation : les économistes les mieux certifiés font tout aussi bonne figure que lui sous le rapport qui nous intéresse. David Thesmar et Augustin Landier étaient formels dès l’été 2007 : sous le titre prophétique « Le mégakrach n’aura pas lieu (12) », le meilleur jeune économiste de France (Prix 2007 du Cercle des économistes, qui sait reconnaître les siens) et son acolyte sont formels : « Disons-le tout net : [la correction] sera limitée et surtout sans effet sur l’économie réelle. » Le fait est que c’est dit assez « net » et, d’ailleurs, conclu de même : « Le danger d’une explosion financière, et donc le besoin de régulation, n’est peut-être pas si grand qu’on le pense. »
Il y a pourtant mieux que les clairvoyants ; il y a les prophètes. « Dans son rapport commandé par l’Elysée, l’économiste prévenait déjà des dangers de la spéculation financière. » C’est sur cet hommage aux capacités extralucides de Jacques Attali et de son fameux rapport que s’ouvre la double page signée Renaud Dély et offerte (par mégarde ?) par Marianne à l’un des produits multimédias les plus célèbres de France. Mais Dély, qui recueille les oracles d’Attali, a-t-il seulement lu une ligne du rapport qu’il encense ? La question se pose car, faut-il le dire, non seulement le rapport Attali ne compte pas la moindre remarque sérieuse quant aux dangers de la déréglementation financière, mais il n’est qu’une longue ode aux prodiges des marchés de capitaux — et une exhortation à s’y rallier plus complètement encore.
Dès la page 7, le modèle qui réussit est indiqué à l’imitation de la France : c’est le Royaume-Uni, qui « s’est engagé durablement dans la valorisation de son industrie financière » — n’est-ce pas là une idée que son excellence range évidemment dans la catégorie du prophétique ? Il y a ainsi « des révolutions à ne pas manquer », celle des « secteurs porteurs » (p. 54) ; parmi eux, « la finance » (id.). C’est pourquoi « faire de Paris une place financière majeure » est l’« objectif » qui préside à la dégelée des propositions 96 à 104.
Décision 97 : « Harmoniser les réglementations financières et boursières avec celles applicables au Royaume-Uni pour ne pas handicaper les acteurs européens par rapport à leurs concurrents internationaux. » Décision 101 : « Multiplier les initiatives communes entre les enseignements supérieurs et les institutions financières dans le financement de chaires dédiées aux recherches sur la modélisation financière », car si l’université doit être condamnée par l’attrition des budgets publics, rien n’est trop beau pour les formations des futures élites de la classe parasitaire. Pour la fin, la meilleure, la décision 103 : « Modifier la composition des commissions et des collèges de régulateurs, pour que les champions de la finance puissent s’exprimer et influencer la position du haut comité de place. »
A ce stade, on rêve d’interviewer l’intervieweur : « Au 10 octobre 2008, quel effet vous fait l’expression “champions de la finance” et plus encore l’idée de leur confier la régulation des marchés ? Pensez-vous que l’auteur de ce genre de propositions, pourtant formulées après plus de six mois de crise financière ouverte (13), entre plutôt dans la catégorie des prophètes ou dans celle des cuistres ? Pensez-vous persister dans le journalisme ou envisagez vous une reconversion dans le microcrédit ? »
Il faudra sans doute laisser à Dély un peu de temps pour mûrir sa réponse et aussi pour déguster la fin du rapport, qui n’est pas moins goûteuse que le commencement puisque la décision 305 lâche enfin le morceau en suggérant de « réorienter massivement le régime fiscal de l’assurance-vie et du plan d’épargne en actions vers l’épargne longue investie en actions (à coupler avec les fonds de pension) ».
Nous y voilà. On ne sait trop si Attali a tout prévu de la crise autrement que sur le mode de l’hallucination rétrospective, mais, en janvier 2008 en tout cas, il est d’avis de propulser toute l’épargne des Français sur les marchés financiers — se peut-il que ce soient les mêmes marchés à propos desquels il dit si bien « tsunami » à la télévision ?
Le rapport Attali plaide donc ouvertement pour le passage à la capitalisation — « la montée en puissance de l’épargne- retraite individuelle ou collective est donc nécessaire » (p. 213) — au moment précis où les ménages américains, du fait de la crise, voient leurs pensions partir en fumée et quand l’extrême détresse où ils se trouvent ne les a pas déjà forcés à puiser dans leurs comptes-retraite. Quel heureux sens de l’histoire de pousser à la capitalisation en une période où l’on ne tardera pas à voir apparaître les premiers vieux miséreux sur les trottoirs des villes américaines !
Et, puisque le message de ce rapport est de soumettre toute la société française à la logique de la finance, qui démontre si spectaculairement ses vertus, on n’oubliera pas de mentionner la décision 22, qui vise à faire monter en puissance le rôle des fondations privées dans le financement des universités avec, on s’en doute, retrait équivalent des financements publics. Mais comment fonctionnent au juste ces fondations ? Elles placent leurs capitaux sur les marchés et vivent à l’année avec « les petits » (les intérêts). Dans les conditions d’effondrement de tous les secteurs de la finance que le prophète a anticipées de longue date, il se pourrait donc que les universités américaines se préparent quelques années au pain sec et à l’eau. N’est-ce pas le modèle qu’il nous faut absolument imiter ?
De tout cela finalement, qui se soucie ? Les girouettes tournent folles mais empêchées par rien. A de rarissimes exceptions près, tous ces gens que Favilla, dans son éditorial bizarrement éclairé, nomme « chefs d’entreprise, universitaires, éditorialistes, responsables politiques » ont organisé leurs débats entre eux et sans que la moindre contradiction sérieuse ne s’y immisce. Il faudrait bien de la naïveté, dans ces conditions, pour s’étonner qu’il n’y ait nulle part dans le système la moindre force de rappel, pas même un commencement de régulation de la décence, la plus petite possibilité de sanction pour de si formidables contradictions, ni de ridicule pour de si gigantesques bouffonneries, dès lors que tous en sont convaincus et choisissent logiquement de s’en absoudre collectivement.
Et contradictoirement pourtant, ayant dit cela que la lucidité impose de toute manière, il faut bien de la tempérance pour ne pas s’ahurir de l’état de cette chose si dégradée qu’ils persistent, par une ironie sans doute involontaire, à appeler « la démocratie », et pour résister à la violente impulsion de leur demander ce que la dignité leur commanderait, s’ils en avaient deux sous : prendre des vacances. Et peut-être même disparaître.